Un élu
Après des mois de maturation, la nouvelle version du Référentiel Général d’Interopérabilité est enfin sortie. L'arrêté, publié au Journal Officiel le 22 avril 2016, officialise le lancement de cette v2. Cette version encourage notamment l'utilisation des formats ouverts pour garantir la pérennité des documents.
Fruit des efforts concertés de la DINSIC, d'experts et contributeurs avertis (voir l'article sur l'appel à commentaires), cette version recense toutes les normes et standards, évalués selon ces critères (la non satisfaction d'un critère n'étant pas éliminatoire) :
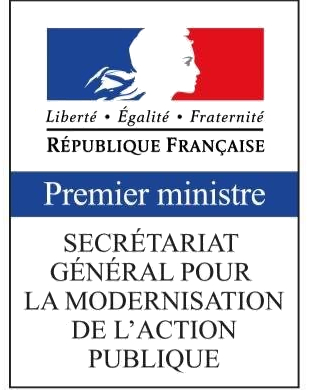
- Ouverture
- Pertinence
- Maturité
- Indépendance
- Facilité de déploiement
- Soutien par l'industrie
Le document retient ensuite neuf typologies d’usage, dont la bureautique. On se souviendra que la question des formats en bureautique avait été l'un des enjeux majeurs lors de l'écriture de la v1, donnant lieu à des échanges musclés entre les partisans du libre et Microsoft.
De fait, pour cette nouvelle version, tous les yeux étaient tournés vers la bureautique... Le nouveau référentiel privilégie clairement le format bureautique ODF, considéré comme suffisamment mature. Le format OpenXML de Microsoft écope lui d'un statut "en observation" ; sans disparaître totalement du référentiel, il se place en retrait, signalant ainsi les réserves émises à son encontre.
La recommandation officielle du format ODF est une excellente nouvelle, qui vient conforter dans leur choix toutes les collectivités et administrations ayant opté pour une suite bureautique libre.
Plusieurs formats et protocoles sont signalés en fin de vie, tels que l'IPv4 (Internet Protocol version 4), PRESTO 2.0 (Protocole d’échange standard et ouvert de l’Administration), TXT (Text File), CSV (recommandé uniquement pour les échanges entre application et utilisateur), ou le format GIF (Graphics Interchange Format).
Pour en savoir plus sur le RGI v2, nous vous conseillons la lecture de cet article : Formats de fichier interopérable : ce qui change avec le RGI 2.0 (Zdnet).
Voir l'arrêté : Arrêté du 20 avril 2016 portant approbation du référentiel général d'interopérabilité via Legifrance
Lire le RGI : Référentiel Général d'Interopérabilité v2 (pdf)
Un Logiciel Libre est un logiciel dont l’auteur a rendu les secrets de fabrication, c’est à dire "le code source" public. Dès lors, le logiciel devient librement accessible et librement utilisable.
Un Logiciel Libre ou "Free Software", est défini par quatre libertés :
- La liberté d’exécuter le programme, pour tous les usages
- La liberté d’étudier le fonctionnement du programme et de l’adapter à vos besoins. L’accès au code source est alors une condition requise
- La liberté de redistribuer des copies, donc d’aider votre voisin
- La liberté d’améliorer le programme et de publier vos améliorations, pour en faire profiter toute la communauté. L’accès au code source est alors une condition requise
Le Logiciel Libre, grâce aux quatre libertés qu’il confère à tous, vise à respecter la liberté de l’utilisateur et la solidarité des communautés informatiques.
En pratique, les Logiciels Libres pouvant être librement utilisés, copiés, modifiés et redistribués par tous et en toute légalité, se sont largement diffusés ces vingt dernières années, et le nombre de contributeurs, au bien commun qu’ils constituent, n’a cessé de croître.
Enjeu de société
Les Logiciels Libres pouvant être copiés légalement par tous, ils sont presque toujours téléchargeables gratuitement sur Internet. Cette gratuité permet aux populations les moins favorisées de ne pas être forcées d’avoir recours à la copie illégale pour bénéficier des avancées technologiques. Les Logiciels Libres sont par nature des outils de lutte contre la "fracture numérique".
Le fait que les Logiciels Libres soient diffusés avec leur code source permet d’étudier les techniques qu’ils mettent en oeuvre, de les réutiliser, de les diffuser, y compris en dehors des structures habituelles d’éducation et de formation. Le mode de développement collaboratif au travers d’Internet utilisé par les développeurs de Logiciels Libres facilite les transferts de compétences par delà les frontières.
Le Logiciel libre est un bien non marchand et ceux qui le développent contribuent à la diffusion au plus grand nombre de la connaissance scientifique, d’un savoir-faire technique et de la technologie permettant l’accès au savoir.
Enjeu économique
Le Logiciel Libre a permis le développement d’une économie dynamique dite de "coopétition" où les opérateurs mutualisent certains coûts de recherche et développement et se concurrencent sur les services autour de briques génériques. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, une véritable économie de services s'est créée autour des Logiciels Libres.
Les entreprises du secteur se rémunèrent sur le support, la formation, l'intégration, le conseil et la spécialisation de briques génériques. Les organisations utilisatrices adhèrent au modèle pour la qualité de l'offre, mais aussi parce que le Logiciel Libre permet plus d'indépendance et une meilleure maîtrise des coûts de maintenance et de développement interne.
Le nombre d'entreprises utilisant des logiciels libres ne cesse de croître et partout dans le monde, des pans entiers des Systèmes d'Information d'États et de Collectivités basculent vers les Logiciels Libres.
Enjeu stratégique
Le Logiciel Libre est de plus en plus perçu par les pouvoirs publics et les décideurs politiques comme :
- Un outil de souveraineté et de politique industrielle
- Un moyen de maîtrise des finances publiques
- Un facteur de développement durable
Le modèle économique du libre
Pour expliquer le modèle économique du libre, il faut d’abord connaître le fonctionnement du modèle libre.
À la différence des logiciels propriétaires, les Logiciels Libres sont créés pour répondre à un besoin identifié directement par les futurs utilisateurs et développeurs du logiciel en question.
Le développement des Logiciels Libres est basé sur un travail collaboratif. Cela implique une force de travail plus importante et un développement plus rapide.
De plus, les spécifications et les améliorations du Logiciel Libre étant directement réalisées par les usagers, le logiciel est parfaitement adapté aux besoins des usagers et peut à tout moment évoluer.
En terme économique, cela signifie une réduction des coûts de production, d’une part liée à l’absence du poste Recherche et Développement, et d’autre part au travail collaboratif.
Mais alors peut-on parler de rémunération dans le monde du libre ?
Et oui, on peut parler de rémunération dans le monde du libre, cela correspond simplement à tous les coûts qui ne se divisent pas, toutes les activités qui ne sont pas mutualisables c’est à dire tous les services autour du Logiciel Libre : formation, maintenance, installation.
On peut relever plusieurs bonnes raisons de choisir le libre. Tout d’abord, pour sa qualité, pour sa réactivité, pour son coût, et pour la liberté que celui-ci confère.
De plus, en choisissant le libre, il vous est possible d’utiliser, de modifier et de transmettre le logiciel.
D’autres bonnes raisons s’ajoutent, notamment la sécurité, l’innovation, la transparence, la libre concurrence et l’interopérabilté.
L'ADULLACT c'est :
- Un support téléphonique sur des questions techniques générales
- Des journées de formation, des séminaires
- Des tests et des validations de logiciels
- L'accès à une plate-forme de dématérialisation de marchés publics et à une plate-forme de tiers de télétransmission
- La participation à des Groupes de Travail* afin de définir ensemble des cahiers des charges
- L'accès à une documentation, un livre blanc et de nombreuses études
* L’ADULLACT met en place, par l’intermédiaire de Groupes de Travail, des projets informatiques libres répondant aux besoins exprimés par ses adhérents. Avec l’aide de son équipe permanente et de plusieurs collectivités pilotes, l’ADULLACT spécifie le champ fonctionnel des projets, fédère les ressources et coordonne les compétences au sein de la communauté qui l’entoure, établit un cahier des charges précis. Sur ce modèle de fonctionnement, plusieurs projets ont vu le jour et continuent d'évoluer.
La Forge : l'ADULLACT a déployé en avril 2003 son site de développement coopératif (adullact.net).
Le principe de ce site est de centraliser l'ensemble des projets portés par l'ADULLACT afin de permettre facilement aux développeurs et aux utilisateurs de passer d'un projet à un autre, pour tester ou pour participer. Au travers de son site de développement, l'ADULLACT souhaite donner un sens concret à l'idée de mutualisation des efforts des collectivités membres.
En février 2008, l’ADULLACT décide, en accord avec la DGME - Direction Générale de Modernisation de l’Etat - de fusionner sa plate-forme avec Admisource, la plate-forme de développement coopératif de l’Etat.
La forge est utilisée pour télécharger le code source d’un logiciel, pour participer à son développement (via CVS ou SVN), pour consulter les archives des projets, héberger des pages web etc.
Basée sur GForge, c’est le moteur de l’ADULLACT, avec plus de 600 projets déposés et plus de 9 000 contributeurs.
Le magasin : son accès est réservé aux adhérents de l’ADULLACT. Il permet de tout savoir sur les logiciels récents (moins de 18 ou 24 mois), et permet de télécharger des logiciels testés, documentés et packagés avec un helpdesk.
Le grenier : contrairement au magasin, le grenier est accessible à tous. Il permet de trouver des logiciels présents auparavant sur le magasin ou qui font référence au monde du libre.
L'espace de démonstration : plusieurs démonstrations de logiciels libres métiers sont proposées sur ce site, allant du parapheur électronique d’ADULLACT au gestionnaire de contenus Lutèce.
Les sites de projet : permettent de tout apprendre sur un projet promu par l’ADULLACT.
Les listes de diffusion thématiques : pour échanger avec les adhérents.
Pour que fonctionne la mutualisation, il ne faut pas seulement prendre ce que l'ADULLACT a à proposer, il faut participer, donner un peu de son temps pour qu'un échange véritable puisse exister.
Vous pouvez donc :
- Participer aux groupes de travail collaboratif, dont la liste est tenue à jour notamment grâce à la lettre de l'ADULLACT
- Faire remonter vos besoins et demander la création d'un groupe de travail collaboratif
- Échanger avec les autres adhérents, notamment sur les listes de diffusion
- Mettre des développeurs à disposition d'un projet en particulier
- Être un relais de l'action de l'ADULLACT dans votre collectivité : sensibilisation au libre, aide technique, information
- Associer l'ADULLACT aux manifestations organisées par votre collectivité
Actualités
-
La Dépendance aux Logiciels Propriétaires : Un Risque Majeur pour les Institutions Publiques
La dépendance aux logiciels propriétaires soulève des défis majeurs, en particulier pour les institutions publiques et les collectivités territoriales. Un incident récent impliquant Microsoft et… En savoir +
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
